Il est nécessaire de faire l'étude de la littérature cubaine depuis les conceptions marxistes-léninistes sur l’histoire, la littérature et l’art. Il n'est pas possible de continuer à évaluer nos processus littéraire, nos écrivains et leurs œuvres représentatives avec des points de vue répondant aux critères obsolètes, les critères de la bourgeoisie créole et leur porte-parole idéologiques. Par conséquent, il faut que les précieuses œuvres du XIXe siècle soient analysées unilatéralement en raison de certains préjugés et certaines discriminations découlant de ces critères. C'est le cas de Cecilia Valdés, le chef-d’œuvre de Cirilo Villaverde (1812-1894), sur lequel se répètent des conclusions révélant la persistance des points de vues de la bourgeoisie qui n’abordent pas de façon appropriée le problème cubain de ce siècle.
Les critiques et les historiens littéraires ne soulignent pas que lors de la première moitié du XIXe siècle a surgit à Cuba un courant littéraire que nous pouvons appelé « le roman antiesclavagiste cubain» avec l’apport d’œuvres n’ayant aucune similitude dans les autres littératures de notre Amérique à la même époque. Ces écrivains ont affronté avec plus ou moins de rigueur et de vaillance le problème de l'esclavage. Il est vrai qu'ils ne précisent pas clairement les objectifs abolitionnistes, ils ne se limitent qu’à présenter les conflits, les confrontations raciales de cette société esclavagiste. Plusieurs romans n’ont pas pu être publiés à Cuba, comme Petronas y Rosalia, écrit en 1838 par Félix Tanco (qui a été publié pour la première fois en 1925) et Francisco, d’Anselmo Suárez y Romero, également écrit en 1838-39 et qui a été publié à New York en 1880. Ils auraient eu moins de possibilités de passer par la rigide censure coloniale s’ils avaient ouvertement proclamé la nécessité d'abolir ce système terrible qui a été la source de richesse des propriétaires d’haciendas et de plantations de canne à sucre. Le thème anti-esclavagiste se réduisait à une approche morale, non pas sociale ; ils ne postulaient qu’à édulcorer (si ce terme n'était pas atrocement ironique) la situation des esclaves producteurs du sucre ; réduire les mauvais traitements auxquels ils étaient soumis, l'implacable exploitation dont souffraient ces êtres humains sans défense, assimilés à des choses ou à des biens, des « pièces d'ébène » et des « sacs de charbon ».
Cirilo Villaverde élargi beaucoup plus son approche. Il ne présente pas seulement le système esclavagiste, mais toute la société coloniale tournant autour du système barbare. Cet objectif ambitieux a conduit le narrateur à présenter toutes les classes et tous les segments sociaux qui constituaient la société de cette époque, depuis le chef politique, le Capitaine Général Vives, et le dessous de la pyramide sociale qui avait sa cime dans l'aristocratie (représenté par Fernando O'Reilly, ami de Leonardo) ; la haute bourgeoisie péninsulaire et créoles des hacendados, des commerçants et des trafiquants d'esclaves ; une petite bourgeoisie libérale de médecins et de professeurs et, plus bas, les petits commerçants et les employés péninsulaires (Galiciens, Catalans, îliens) l’horloger, l’épicier, le majordome de Gamboa, etc. et les employés créoles ayant divers métiers dans la ville ou à la campagne. Beaucoup plus bas, le monde des Noirs et des Mulâtres libres, qui déjà dans ces années atteignait un niveau économique causant la méfiance des autorités coloniales et provoquerait l’horrible répression de la « Conspiration de la Escalera » en 1844. À ce monde appartenaient les artisans et les musiciens, comme le tailleur Uribe et le musicien José Dolores Pimienta. Cecilia et son amie Nemesia correspondent à ce segment qui est l’axe du roman. Enfin, à la base de la pyramide, se trouvent les esclaves qui ne sont rien de plus que des choses, des biens, mais pour lesquels Villaverde parvient à insuffler une personnalité, une vie, une singularité.
Villaverde décrit avec minutie les us et coutumes des Noirs et des Mulâtres affranchis. Si le protagoniste est un esclave dans Francisco, comme c'est le cas avec Sab, le personnage principal du roman antiesclavagiste de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Villaverde choisit comme noyau de son roman le monde des Mulâtres affranchis. En eux nous voyons un profond complexe d'infériorité, un visqueux rejet de la race noire, une constante négation de leur origine ethnique africaine. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement pour des aspirations d’ascension sociale, mais dans cette société esclavagiste, l’origine africaine, la peau foncée, représentaient une discrimination totale, un obstacle presque insurmontable, un assujettissement à tous les abus et à toutes les provocations. Cecilia Valdés est, dans ce sens, un personnage type : elle supporte les Mulâtres et rejette indubitablement les Noirs, aspire à monter les échelons dans la structure sociale qui prévaut et cette possibilité - la seule possibilité que lui permet ce régime - était la relation avec un Blanc. La tragédie de Cecilia repose sur les conseils que lui donne sa grand-mère Ña Chepilla (première partie, chapitre III). L'abnégation du Noir se manifeste également dans les relations que maintient l'esclave María de Regla, un des personnages les plus habilement dessinés par Villaverde, avec ses enfants Dolores et Tirso.
On entrevoit déjà la semence de la rébellion parmi les Mulâtres affranchis. José Dolores représente un secteur en plein essor au sein du métissage progressif. La conversation entre José Dolores et le tailleur Uribe (seconde partie, chapitre I) permet de connaître la non-conformité et le ressentiment latent dans une « classe » ou un secteur déterminé. Les paroles d’Uribe sont suffisamment claires : « Laisse le temps passer, chinito , un certain un jours ça sera à nous » . Mais, ces mots sont-ils « propre » à ce personnage, ou représentent-ils la « peur du Noir » sur laquelle ont tant insisté les idéologues de la bourgeoisie réformiste, tels que José Antonio Saco ? Combien avait-il de Villaverde dans ces paroles amères ?
Consciemment ou inconsciemment, Villaverde révèle la situation réelle de l'île dans ce roman-témoignage : malgré l'esclavage et la discrimination raciale, nonobstant l'ambiance explosive causée par les violents affrontements raciaux et de classe, l'intégration raciale, le métissage, le lien entre les deux races se produit. Le Créole et le Métisse imposent leur physionomie et leur profil à la population insulaire. L'un et l'autre, malgré les antagonismes existants, se placent face au gouvernement colonial espagnol, aussi bien contre l'esclavage que le colonialisme. Il n'était pas possible de conquérir l'indépendance de ce pays si en même temps on ne donnait pas la liberté à tous ses habitants, c'était la disparition de l'esclavage. C’est de ce chaudron chauffé au rouge que surgira l'élan frénétique qui provoquera la lutte pour la libération, les guerres d'indépendance à partir de 1868.
Dès les premiers chapitres du roman nous tombons brusquement au milieu des problèmes conflictuels de la colonie esclavagiste. En lisant le chapitre sept de la première partie, qui décrit la vie et les coutumes de la famille Gamboa, nous voyons le cadre des relations maître-esclave. C’est seulement ici que l’on nous offre la situation de l'esclave domestique, distincte à celle plus brutale de l'esclave rural dans la plantation de canne à sucre. Plus nous progressons dans le roman, plus nous nous enfonçons dans le monde ténébreux de l'esclavage tachant aussi bien le maître que l'esclave d’une empreinte indélébile. Villaverde, avec une approche embrassante, capte non seulement les relations entre maîtres et esclaves mais les relations d'esclaves à esclaves. Nous ne sommes pas surpris en connaissant la lutte entre un esclave de « nation » (d'origine africaine) avec un Mulâtre havanais. Nous voyons aussi, grâce au pouvoir plastique du romancier, l'estampe d'une vente aux enchères d'esclaves et nous pouvons voir la scène de la mère, tête basse et à demi couverte par une couverture en coton entourée de ses jeunes enfants agrippés à sa jupe.
L’auteur présente dans son œuvre toute une gamme de sentiments, depuis les plus bas et morbides jusqu’aux plus sublimes et compatissants. L’indifférence de la part du négrier devant ces hommes dont le sort l'intéresse seulement quand il peut influer sur son économie. Le dialogue révélateur de Cándido Gamboa avec son épouse Rosa (seconde partie, chapitre II). Pour les « négriers » ces hommes sont seulement des « sacs de charbon », des « pièces d'ébène ». Rosa permet de montrer un peu de compassion pour les enfants des esclaves jetés dans l'océan par le capitaine du négrier poursuivit par un navire de guerre anglais. La troisième partie du roman, qui raconte la visite de la famille Gamboa et de leurs amis à l’exploitation La Tinaja, permet de connaître la face la plus terrible de l'esclavage, sa bassesse et ses cruautés.
Dans cette troisième partie sont présentées les punitions que recevaient les esclaves : le bocabajos ou cep, le cuero ou fouet. Plusieurs esclaves s’étaient enfuis ; certains des cimarrones sont arrêtés et l'un d'eux, Pedro Carabalí, se suicide en avalant sa langue ; lors d'une promenade, Leonardo et ses jeunes amis trouvent le cadavre d'un esclave qui s'était suicidé, pendu à un arbre, mangé par les urubus. Ces pages semblent des anticipations naturalistes, tel est l'environnement morbide, sale et horrible que dessine le romancier. Les invités de Gamboa parlent des conditions des esclaves, laissant voir leur discrimination et leur ignorance, la seule réfléchissant sur ce que sera son avenir si elle épouse le fils du propriétaire de l'exploitation est Isabel Ilincheta, la fiancée officielle de Leonardo, dans son soliloque elle nous dit :
« …... l'esclavage est pervers, car progressivement et imperceptiblement il infiltre son venin dans l'âme des maîtres, perturbe toutes leurs idées du juste et de l'injuste, convertissant l'homme en un être irascible et arrogant...
Cecilia Valdés plus qu'un roman réussi formellement, est plutôt un feuilleton mélodramatique dont les personnages réagissent avec excès à un manichéisme mal fait, pêchant souvent de superficialité. Mais, comme l’avait déjà expliqué Manuel de la Cruz au XiX siècle , ce roman doit être évalué comme une œuvre d'art, d'une part et d'autre part, comme un document historique et social. Même si on peut voir de nombreux défauts et de nombreuses erreurs dans la forme (son langage, son style et sa structure), il est d'une valeur inestimable pour savoir comment était Cuba au milieu du XIXe siècle, comment était la société coloniale et esclavagiste. Si Karl Marx a affirmé qu'il avait appris plus l'économie dans les romans de Balzac que dans les travaux des économistes, nous pouvons dire —en gardant les distances — que dans Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde nous pouvons mieux savoir comment était la société cubaine que dans les manuels d'histoire de ce siècle car dans ses pages les conditions de ce régime exploiteur, bouillonnent, choquent, s’affrontent, on voit les violentes confrontations entre lesquelles se forgeait la nationalité cubaine.
* En octobre 1974, à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de la mort de Cirilo Villaverde, le Conseil National de la Culture a organisé plusieurs cérémonies commémoratives à San Diego de Núñez et à Pinar del Rio, la région natale du notable narrateur. De même, la Section de Littérature de l'Union des Écrivains et des Artistes de Cuba a préparé une cérémonie en souvenir de cet anniversaire. À l'occasion de la célébration du quinzième anniversaire de la fondation du Département Circulant de la Bibliothèque Nationale José Martí, l'auteur de ces lignes a offert une conférence reconstruisant en partie la présente chronique.
Prix dans : Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, janvier-avril 1975, pages 145 à 150.

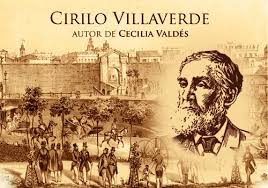
Deje un comentario