Fidel Castro et le coup d’Etat du 11 avril 2002 contre le président vénézuélien Hugo Chávez
Avez-vous suivi de près l’évolution de la situation au Venezuela, en particulier les tentatives de renversement du président Chávez ?
Oui, nous avons suivi tous ces événements avec beaucoup d’attention. Chávez nous avait rendu visite en 1994, neuf mois après sa sortie de prison et quatre ans avant sa première élection à la présidence. C’était très courageux de sa part, car il a essuyé toutes sortes de reproches pour s’être rendu à Cuba. Il est donc venu, et nous avons beaucoup discuté. J’ai découvert un homme cultivé, intelligent, très progressiste, un authentique bolivarien. Et puis, il a remporté les élections. À plusieurs reprises. Il a modifié par référendum la Constitution. Grâce à l’appui formidable du peuple. Ses adversaires ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, de s’en prendre à lui par la force ou de l’asphyxier économiquement. Mais il a su faire front et défendre, face à toutes les attaques de l’oligarchie et de l’impérialisme, le processus bolivarien.
Pendant les quarante années de la fameuse démocratie qui a précédé l’élection de Chávez, on estime à près de 300 milliards de dollars les sommes qui ont quitté le Venezuela, selon des calculs réalisés par des cadres du monde bancaire. Le Venezuela aurait pu devenir un pays plus industrialisé que la Suède, et atteindre le même niveau d’éducation que ce pays si une véritable démocratie distributive avait été appliquée et si les mécanismes démocratiques avaient vraiment fonctionné. Bref, si quelque chose avait été vrai et crédible dans toute cette démagogie et cette publicité colossale qui étaient la norme avant Chávez.
Il faut ajouter qu’entre le moment où Chávez a été élu en 1998 et l’instauration du contrôle des changes en janvier 2003, la fuite de capitaux — d’après nos estimations — s’est encore élevée à près de 30 milliards de dollars. Les phénomènes de ce genre rendent l’ordre existant en Amérique latine insoutenable.
Un coup d’Etat a eu lieu le 11 avril 2002 à Caracas contre Chávez. Avez-vous suivi ces événements ?
Ce 11 avril, quand nous avons appris, à midi, que la manifestation convoquée par l’opposition avait été déviée par les putschistes et qu’elle s’approchait du palais de Miraflores, j’ai tout de suite compris que de graves événements étaient sur le point d’éclater. En fait, je suivais en direct le déroulement de cette marche sur la chaîne publique Venezolana de television, qui diffusait encore à ce moment-là. Très vite, les provocations se sont succédé, les coups de feu fusaient, faisant de nombreuses victimes. Quelques minutes après seulement, Venezolana de television a cessé de retransmettre. Les nouvelles ont commencé à nous parvenir par bribes et par différentes voies. On a appris que certains hauts officiers s’étaient prononcés publiquement contre le président. On affirmait que la garnison présidentielle s’était retirée, et que l’armée était sur le point d’attaquer le palais de Miraflores.
Des personnalités vénézuéliennes téléphonaient à leurs amis à Cuba pour leur faire leurs adieux car elles étaient déterminées à résister et à mourir ; elles parlaient concrètement de s’immoler. Ce soir-là, j’ai réuni dans une salle du palais des Conventions le Comité exécutif du Conseil des ministres. Depuis la fin de la matinée, j’étais accompagné par une délégation officielle du Pays basque espagnol, présidée par le Lehendakari [Juan José Ibarretxe], que nous avions invitée à déjeuner quand nul n’imaginait ce qui allait se produire au cours de cette journée tragique. Cette délégation a été témoin de ce qui s’est passé chez nous ce 11 avril, entre 13 heures et 17 heures.
Très tôt dans l’après-midi, j’avais essayé de joindre le président vénézuélien par téléphone. Impossible ! En pleine nuit du 12 avril, à 0 h 38, c’est finalement Chavez qui m’appelle.
Je lui demande où en est la situation. Il me répond : « Nous nous sommes retranchés dans le palais. Nous avons perdu la seule force militaire qui aurait pu agir. On nous a ôté toute possibilité de communiquer par télévision. J’analyse la situation, mais je ne dispose d’aucun moyen militaire. » Très rapidement, je lui ai demandé : « Combien d’hommes as-tu sous tes ordres ? — Entre 200 et 300, mais tous sont exténués. — As-tu des tanks ? — Non, nous en avions, mais ils ont tous regagné leur quartier général. »
Et moi, de nouveau : « Quelles sont les autres forces dont tu pourrais disposer ? » Il me répond : « Il y a d’autres troupes, mais elles sont trop loin, et je n’arrive pas à entrer en contact avec elles. » Il faisait référence au général Raúl Isaías Baduell et à ses parachutistes de la division blindée, et à d’autres forces d’intervention, mais il lui était impossible d’entrer en contact avec ces unités boliviennes loyales.
Avec le maximum de délicatesse, je lui ai alors demandé s’il me permettait de lui faire une suggestion. « Puis-je te donner mon avis ? — Je t’écoute », m’a-t-il répondu.
Je lui ai alors suggéré, en essayant d’être le plus persuasif possible : « Présente les conditions d’un arrangement honorable et digne, afin de préserver la vie des hommes qui t’entourent, ce sont les plus loyaux. Ne les sacrifie pas, et toi non plus. »
Il me répond, la voix pleine d’émotion : « Tous sont prêts à mourir ici. » J’ai donc enchaîné, sans perdre une seule seconde : « Je n’en doute pas, mais je crois pouvoir réfléchir de façon plus sereine que toi en ce moment. Ne démissionne pas, exige des conditions honorables et des garanties pour ne pas être victime d’une félonie, car je pense que tu dois rester en vie. Par devoir vis-à-vis de tes compagnons. Ne t’immole pas ! » Il était très clair pour moi que la situation dans laquelle se trouvait Chávez ce 12 avril 2002 était profondément différente de celle qu’avait connue Salvador Allende le 11 septembre 1973. Allende n’avait pas un seul soldat. Chávez, lui, pouvait compter sur la majorité des soldats et sur de nombreux officiers de l’armée, particulièrement les plus jeunes. Je lui répétais : « Ne démissionne pas ! Ne te démets pas ! »
Nous avons abordé d’autres questions : la manière dont je pensais qu’il devait abandonner provisoirement le pays, et comment me mettre en rapport avec un officier qui exercerait une véritable autorité dans les rangs putschistes pour lui indiquer que Chávez était disposé à quitter le pays, mais sans démissionner pour autant. À Cuba, nous allions essayer de mobiliser l’ensemble du corps diplomatique, et envoyer deux avions à Caracas avec notre ministre des Relations extérieures et un groupe de diplomates étrangers pour tenter de ramener Chávez ici. Il a réfléchi quelques secondes, puis a finalement accepté ma proposition. Maintenant, tout dépendait du chef militaire ennemi.
Dans le livre [de Rosa Miriam Elizalde et Luis Báez] Chávez nuestro, José Vicente Rangel, alors ministre de la Défense, qui serait ensuite vice-président, qui se trouvait au côté de Chávez au moment des faits, affirme textuellement dans un entretien avec les auteurs : « Le coup de téléphone de Fidel a été décisif et déterminant pour éviter l’immolation. Ses conseils nous ont aidés à voir clair dans l’obscurité. Il nous a beaucoup aidés. »
Avez-vous encouragé Chávez à résister les armes à la main ?
Non, au contraire. C’est ce qu’avait fait Salvador Allende avec héroïsme, selon moi, et c’était ce qu’il devait faire vu les circonstances, mais il l’a payé courageusement de sa vie, comme il s’y était engagé.
Chávez avait trois solutions : se retrancher à Miraflores et résister jusqu’à la mort ; sortir du palais et tenter de rassembler le peuple pour déclencher une résistance nationale, avec de très faibles probabilités de succès, vu la situation ; ou bien abandonner le pays sans démissionner ni se démettre, dans le but de reprendre la lutte avec de fortes chances de l’emporter rapidement. Nous lui avons suggéré de choisir la troisième option.
Mes derniers mots, lors de cette conversation téléphonique, étaient fondamentalement choisis pour le convaincre : « Sauve ces hommes si courageux qui luttent en ce moment à tes côtés dans cette bataille pour l’instant inutile. » Mon idée était la suivante : j’avais la conviction qu’un dirigeant aussi populaire et charismatique que Chávez serait, après avoir été renversé et trahi dans de telles circonstances, et si on ne le tuait pas, réclamé par le peuple avec encore plus de force — et cette fois avec le soutien du meilleur des forces armées, j’en étais convaincu —, et qu’il reviendrait inévitablement au pouvoir. Voilà pourquoi j’ai pris la responsabilité de lui proposer ce plan. À ce moment précis, quand on a entrevu la réelle possibilité d’un retour victorieux et rapide de Chávez, il n’était plus question qu’il meure en combattant, comme l’avait si héroïquement fait Allende. Et ce retour victorieux de Chávez s’est effectivement produit bien avant, ce que je n’aurais jamais imaginé.
Comment avez-vous essayé d’aider Chavez depuis La Havane ?
Eh bien, la seule chose que nous pouvions faire à partir d’ici, c’était de recourir à la diplomatie. En pleine nuit, nous avons convoqué à La Havane tous les ambassadeurs accrédités et nous leur avons proposé d’accompagner notre ministre des Relations extérieures Felipe [Pérez Roque] à Caracas, pour récupérer pacifiquement Chávez, président légitime du Venezuela.
Il ne faisait aucun doute pour moi qu’en très peu de temps Chávez serait de retour, porté en triomphe par le peuple et par ses troupes. Pour l’heure, il fallait juste empêcher qu’il se fasse tuer.
Nous avons proposé d’envoyer deux avions, au cas où les putschistes accepteraient qu’il parte en exil. Mais le chef militaire des putschistes a refusé la proposition, et il a dans le même temps annoncé à Chávez qu’il serait traduit devant un conseil de guerre. Chávez a alors endossé son uniforme de parachutiste et, accompagné de son fidèle assistant, Jesús Suárez Chourio, il s’est rendu au fort Tiuna, le quartier général des militaires putschistes. Quand je l’ai rappelé, comme convenu, deux heures après son appel, Chávez avait déjà été fait prisonnier par les putschistes et il n’y avait plus de contact avec lui. La télévision repassait en boucle la nouvelle de sa « démission » afin de démobiliser ses partisans et le peuple. Mais, toujours ce 12 avril, quelques heures plus tard, Chávez s’est débrouillé pour passer un coup de téléphone. Il a pu ainsi parler à sa fille María Gabriela. Il lui a dit qu’il n’avait pas démissionné, qu’il était un « président emprisonné ». Et il lui a demandé de me tenir informé pour que je diffuse cette information partout.
Aussitôt sa fille me contacte, vers 10 heures du matin, et me rapporte ce que lui a dit son père. Je lui demande : « Serais-tu disposée à répéter au monde entier ce que tu viens de me dire ? » Elle m’a dit ceci : « Je ferai n’importe quoi pour mon père », phrase admirable qui témoignait de sa détermination.
Je suis alors entré en contact avec Randy Alonso, journaliste et animateur du programme de la télévision cubaine Table ronde. Muni d’un dictaphone, Randy a contacté María Gabriela sur son portable. Il était presque 11 heures du matin. On a enregistré la déclaration de Gabriela, qui s’exprimait de manière claire et posée, très convaincante, puis nous l’avons retranscrite ; et envoyée à toutes les agences de presse accréditées à Cuba. Ces propos ont été diffusés au Journal télévisé cubain vers 12 h 40. On avait également remis l’enregistrement aux chaînes de télévision internationales accréditées à La Havane.
La CNN, complice, n’arrêtait pas de diffuser depuis le Venezuela les nouvelles de source putschiste ; mais vers midi, leur correspondante à La Havane a pu retransmettre la déclaration on ne peut plus éclairante de María Gabriela qui a fait l’effet d’une bombe.
Et quelles en ont été les conséquences ?
Eh bien, cette information est arrivée aux oreilles de millions de Vénézuéliens, majoritairement antiputschistes, ainsi qu’à celles des militaires demeurés fidèles à Chávez, mais qui avaient été trompés et paralysés par les rumeurs mensongères de sa démission.
Vers 23 h 15, María Gabriela m’a rappelé. Un accent tragique dans la voix. Je ne l’ai pas laissée finir sa phrase, je lui ai demandé : « Que s’est-il passé ? — Mon père a été transféré cette nuit, par hélicoptère, vers une destination inconnue. » Je lui ai dit : « Alors il faut agir sur-le-champ, les gens doivent entendre cette nouvelle au plus vite, de ta propre bouche. » Randy était près de moi, nous participions à une réunion sur les programmes de la « bataille des idées » avec des dirigeants des Jeunesses communistes et d’autres cadres ; il avait un dictaphone avec lui, et nous avons recommencé ce que nous avions fait à midi le jour même. L’opinion vénézuélienne et le monde entier ont été informés du transfert de Chávez, en pleine nuit, vers une destination inconnue. Nous étions dans la nuit du 12 au 13 avril 2002.
De très bonne heure le samedi 13, j’ai participé à une tribune ouverte à Güira de Melena, une commune de la grande banlieue de La Havane. De retour à mon bureau, un peu avant 10 heures du matin, je reçois un nouvel appel de María Gabriela. Elle me dit que les parents de Chávez sont inquiets, et qu’ils souhaitent me parler depuis Sabaneta [ville natale de Chávez], dans l’État vénézuélien de Barinas, et faire une déclaration. Je l’informe qu’une agence de presse internationale est en train de diffuser une annonce selon laquelle Chávez aurait été conduit à Turiamo, une base navale située dans l’État d’Aragua, sur la côte nord du Venezuela. Je lui dis que, vu les précisions et les détails, cette nouvelle semble véridique. Je lui recommande d’essayer d’en savoir davantage à ce sujet. Elle m’indique que le général Lucas Rincón, inspecteur général des forces armées, souhaite également s’entretenir avec moi par téléphone et qu’il veut faire, lui aussi, une déclaration publique.
La mère et le père de Chávez me téléphonent alors ; tout est normal, selon eux, dans l’État de Barinas. La mère m’informe que le chef de la garnison locale vient de parler avec son époux, Hugo de los Reyes Chávez, père du président et gouverneur de cet État. J’ai essayé de les tranquilliser du mieux que je pouvais.
Le maire de Sabaneta, le lieu de naissance de Chávez, m’appelle à son tour. Il veut, lui aussi, faire une déclaration à la presse internationale. Au passage, il m’apprend que Chávez peut vraiment compter sur la loyauté de toutes les garnisons. Son optimisme est perceptible. Je m’entretiens avec le général Lucas Rincón. Il m’affirme que la brigade des parachutistes, la division blindée et la base de chasseurs-bombardiers F-16 s’opposent au coup d’État et sont prêtes à intervenir. Je me hasarde à lui suggérer de faire le maximum pour essayer de trouver une solution sans que les militaires en viennent à se battre entre eux. Il était évident que le coup d’État allait vers l’échec. Nous n’avons pas pu recueillir la déclaration du général Lucas Rincón parce que la communication a été coupée et qu’il a été impossible de la rétablir.
Quelques minutes après, María Gabriela appelle de nouveau pour me dire que le général Raúl Isaías Baduell, chef de la brigade des parachutistes, veut me parler, et que les forces loyales de la base de Maracay, des troupes d’élite, désirent adresser une déclaration au peuple du Venezuela et à l’opinion internationale.
J’étais très désireux d’en savoir d’avantage, et j’ai donc immédiatement appelé le général Baduell pour qu’il me précise quelques détails, avant de poursuivre notre conversation. Il m’a répondu et a complètement satisfait ma curiosité ; de chacune de ses phrases émanait une grande combativité. Je lui ai aussitôt dit : « Tout est prêt pour votre déclaration. » Mais il m’a demandé d’attendre un peu : « Je vous passe le général de division Julio García Montoya, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité et de défense. Il nous a rejoints pour apporter tout son soutien à notre position. » Montoya, plus âgé que les jeunes chefs militaires de la base de Maracay, ne commandait pas de troupes à ce moment-là.
Le général Baduell me passe alors le général García Montoya. Très respectueux de la hiérarchie militaire, Baduell était à la tête de la brigade de parachutistes qui constituait un pilier fondamental de cette base de Maracay qui comptait également d’autres puissantes composantes : des chars, de l’infanterie blindée et une escadrille de chasseurs-bombardiers. Cette base se trouvait précisément dans l’État d’Aragua. García Montoya, officier le plus haut gradé, a fait preuve, dans ses propos, d’une grande intelligence ; son plan était fort convaincant et très adapté à la situation. Il m’a affirmé que, au fond, les forces armées vénézuéliennes demeuraient fidèles à la Constitution. Il avait tout dit.
Avec mon téléphone portable et le magnétophone de Randy, je m’étais transformé en une sorte de reporter de presse, qui recevait et diffusait les nouvelles et les déclarations publiques. J’étais témoin de la formidable contre-attaque du peuple et des forces armées bolivariennes du Venezuela.
À ce moment-là, la situation était excellente. Le coup d’État du 11 avril n’avait plus la moindre chance de succès. Mais un risque terrible menaçait encore notre pays frère : la vie de Chávez était en danger. Séquestré par les putschistes, Chávez était tout ce qui restait aux oligarques pour essayer de mener à bien leur aventure fasciste. Qu’allaient-ils faire de lui ? L’assassiner ?
Étancheraient-ils leur soif de vengeance et de haine en tuant ce rebelle et audacieux militant bolivarien, ami des pauvres, défenseur inlassable de la dignité et de la souveraineté du Venezuela ? Que se passerait-il si on apprenait que Chávez avait été assassiné ? La même chose que lors du meurtre de Gaitán, à Bogota en 1948 ? Je ne pouvais m’empêcher de penser aux conséquences sanglantes et destructrices qu’une pareille tragédie déclencherait. Au fil des heures, et après tous ces appels, des échos de l’indignation et de la rébellion populaires nous parvenaient de tous les côtés. À Caracas, centre des principaux événements, une véritable marée humaine envahissait les rues et les avenues vers le palais de Miraflores et vers le quartier général des putschistes. J’étais en proie au désespoir, à cause de l’emprisonnement de mon ami et frère, et une foule d’idées me passaient par la tête. Que pouvais-je faire avec mon simple téléphone portable ? J’étais sur le point d’appeler moi-même le général Efraín Vázquez Velazco en personne. Je ne lui avais jamais parlé et j’ignorais tout de sa personnalité. Je ne savais pas s’il consentirait à me répondre, ni comment. Et pour cette mission assez particulière, je ne pouvais pas compter sur les précieux services de María Gabriela.
J’ai donc cherché une meilleure solution. À 16 h 15, j’ai appelé notre ambassadeur au Venezuela, Germán Sá nchez. Je lui ai demandé s’il pensait que Vázquez Velazco me répondrait ou non. Il m’a dit qu’il y avait de grandes chances pour qu’il accepte. « Appelez-le de ma part, lui ai-je demandé, et dites-lui que, vu les événements, selon moi, le Venezuela risque bientôt de voir un fleuve de sang courir dans les artères de ses villes. Dites-lui que seul un homme peut éviter cette tragédie : Hugo Chávez. Exhortez-le à le relâcher immédiatement, pour dévier le cours probable des événements. »
Le général Vázquez Velazco a accepté de répondre au téléphone. Il a affirmé qu’il détenait bien Chávez, qu’il lui garantissait la vie sauve, mais qu’il ne pouvait pas accéder à notre demande. Notre ambassadeur a insisté et argumenté pour tenter de le convaincre. Mal à l’aise, le général Vázquez Velazco a coupé court à la conversation en raccrochant. J’ai tout de suite appelé María Gabriela pour l’informer de ce que nous avait dit Vá zquez Velazco, notamment sur ses intentions de ne pas porter atteinte à la vie de son père. Je lui ai demandé de me repasser Baduell, que j’ai réussi à joindre vers 16 h 50. Je lui ai relaté en détail ce que s’étaient dit notre ambassadeur Germán Sánchez et le général Vázquez Velazco. Je lui ai signalé qu’il me semblait très important qu’il ait admis détenir Chávez. Toutes les circonstances me paraissaient réunies pour faire toute la pression sur Vá zquez Velazco.
À ce moment-là, à Cuba, nous ne savions toujours pas avec certitude où Chávez avait été transféré. Depuis des heures, la rumeur courait qu’il avait été conduit sur l’île d’Orchila. Quand j’ai parlé à Baduell, un peu avant 17 heures, le chef de la brigade de parachutistes était déjà en train de sélectionner les hommes et de préparer les hélicoptères pour porter secours au président Chávez. J’imagine combien cela a dû être difficile pour Baduell et ses parachutistes de réunir un maximum d’informations précises pour une mission aussi délicate.
Jusqu’à la fin de cette journée du 13 avril, j’ai passé mon temps à parler avec toutes les personnes susceptibles de nous aider à sauver le président Chávez. Dieu sait à combien de gens j’ai parlé. Parce que l’après-midi même, avec l’appui des chefs et des soldats de l’armée, le peuple était en train de reprendre le contrôle de la situation. J’ignore toujours comment, et à quelle heure, Pedro Carmona, le Bref, a abandonné le palais de Miraflores. Je savais que l’escorte de Chávez, aux ordres de José Suárez Chourio, ainsi que les membres de la garde présidentielle avaient repris le contrôle des points stratégiques du palais présidentiel, et je savais que José Vicente Rangel, qui avait été d’une fermeté exemplaire, était revenu au ministère de la Défense.
J’ai même appelé Diosdado Cabello, aussitôt après sa prise de fonction comme président provisoire. Quand nous avons été coupés, à cause d’un écueil technique, j’ai fait passer le reste du message par Héctor Navarro, le ministre de l’Éducation supérieure, en demandant à Cabello d’user de son statut de président constitutionnel pour ordonner au général Vázquez Velazco de libérer Chávez, et de le prévenir des risques auxquels il s’exposait en cas de refus. J’ai parlé à presque tout le monde. Je me sentais complètement impliqué dans un drame dans lequel m’avait précipité le coup de téléphone de María Gabriela le matin du 12 avril. Et encore, c’est seulement après avoir connu tous les détails du calvaire de Hugo Chávez, depuis sa déportation en pleine nuit du 12 avril vers une destination inconnue, que j’ai vraiment réalisé quels dangers incroyables il avait dû affronter, et à quel point il avait fait preuve d’acuité mentale, de sérénité, de sang-froid et d’instinct révolutionnaire. Encore plus incroyable : jusqu’à la dernière minute, les putschistes lui ont caché ce qui se passait dans le pays. Et jusqu’au bout ils ont cherché à l’obliger à signer sa lettre de démission. Mais il ne l’a jamais fait. Un avion privé, appartenant à un célèbre représentant de l’oligarchie, dont je ne mentionnerai pas le nom faute d’être totalement certain de son identité, attendait Chávez pour l’emmener on ne sait où, et pour le remettre à on ne sait qui.
Voilà, je vous ai dit tout ce que je sais. D’autres que moi écriront un jour cette histoire en y apportant sans doute tous les détails qu’on ne connaît pas encore.
Chavez est un représentant des militaires progressistes. Mais en Europe, comme en Amérique latine, de nombreux progressistes lui reprochent justement d’être un militaire. Que pensez-vous de cette apparente contradiction entre le progressiste et le militaire ?
Omar Torrijos, au Panama, est l’exemple même du militaire profondément conscient du sens de la justice sociale et de la souveraineté nationale. Juan Velasco Alvarado, au Pérou, a également réalisé d’importantes réformes qui ont apporté de notables progrès. Il ne faut pas oublier, parmi les Brésiliens, Luis Carlos Prestes, par exemple, un officier révolutionnaire qui a effectué une longue marche héroïque en 1924-1926, presque comparable à celle que ferait Mao Zedong en 1934-1935.
Jorge Amado a écrit un très beau roman sur cette marche de Luis Carlos Prestes, Le Chevalier de l’espérance, un roman magnifique. Cet exploit militaire, qui a duré plus de deux ans et demi, a vraiment été impressionnant ; deux ans pendant lesquels Prestes et ses hommes ont parcouru les immenses territoires de leur pays sans jamais essuyer une seule défaite. Certaines des prouesses révolutionnaires du XXe siècle ont été réalisées par des militaires. Parmi bien d’autres, je peux vous citer les noms d’illustres militaires, comme Lázaro Cárdenas, un général de la révolution mexicaine qui a nationalisé le pétrole en 1938 et procédé à des réformes agraires qui lui ont valu un très large soutien du peuple.
Il ne faut pas non plus oublier que parmi les premiers à s’être soulevés en Amérique centrale dans les années 1950, il y avait des officiers guatémaltèques, un groupe de jeunes sous les ordres d’un haut gradé de l’armée du Guatemala, Jacobo á rbenz. Ils ont participé à de nombreuses activités révolutionnaires historiques, comme par exemple la courageuse réforme agraire qui a provoqué l’invasion mercenaire, qui, pour les mêmes raisons que celle de la baie des Cochons, a lancé l’impérialisme contre ce gouvernement qui mérite l’appellation de progressiste.
Bref, on compte un bon nombre de militaires progressistes. Juan Domingo Perón, en Argentine, était aussi militaire à l’origine. Quand il fait son apparition en politique en 1943, il est nommé ministre du Travail et fait voter des lois très favorables aux travailleurs. Au point que, lorsqu’il sera emprisonné, c’est le peuple lui-même qui viendra le délivrer. Perón a commis quelques erreurs : il a offensé l’oligarchie argentine, il l’a humiliée en nationalisant son théâtre et quelques autres institutions symboles de la classe aisée, laquelle a cependant réussi à conserver intact son pouvoir avec l’aide et la complicité des États-Unis. Ce qui fait toute la grandeur de Perón, c’est qu’il a su exploiter les réserves et les ressources immenses de ce pays si riche qu’est l’Argentine, et amélioré les conditions de vie des travailleurs. Cette classe sociale, toujours reconnaissante et fidèle à l’égard de ses bienfaiteurs, a fait de Perón, jusqu’à la fin de sa vie, une idole du petit peuple.
Le général Líber Seregni, qui était, il n’y a pas longtemps encore, le président du Front élargi en Uruguay, est un des leaders les plus progressistes et les plus respectés qu’ait connus l’Amérique latine. Son intégrité, sa décence, sa fermeté et sa ténacité ont contribué à la victoire historique de ce noble peuple, qui a élu [en octobre 2004] Tabaré Vázquez, son successeur à la tête du Front élargi, à la présidence de l’Uruguay, alors que ce pays se trouvait au bord de l’abîme. Cuba remercie Líber Seregni d’avoir su, avec de nombreux Uruguayens éminents, forger des bases solides aux relations fraternelles et solidaires qui existent aujourd’hui entre nos deux pays.
N’oublions pas, bien sûr, le colonel Francisco Caamaño, ce jeune militaire dominicain qui, pendant des mois, a combattu héroïquement contre les quarante mille soldats des États-Unis que le président Lyndon Johnson avait fait débarquer en République dominicaine en 1965 pour empêcher le retour du président constitutionnel, Juan Bosch. Sa résistance tenace face aux envahisseurs, alors qu’il ne commandait qu’une poignée de militaires et de civils, représente l’un des épisodes révolutionnaires les plus glorieux que ce continent ait connus. Après une trêve qu’il réussit à arracher à l’empire, Caamaño partit en exil puis il rentra dans sa patrie quelques années plus tard, décidé à la libérer de la dépendance des États-Unis. Il a donné sa vie en combattant pour la libération de son peuple, en 1973.
Sans un homme comme Hugo Chávez, issu d’une famille modeste et formé à la discipline des académies militaires du Venezuela, où l’on enseigne les idées de liberté, d’unité et d’intégration latino-américaine héritées de Bolívar, jamais notre Amérique n’aurait connu, en ce moment décisif de son histoire, l’expérience politique d’une transcendance historique et internationale inédite, somme toute révolutionnaire, que le Venezuela connaît aujourd’hui. Je ne vois, entre militaires et progrès, aucune contradiction.
Paris, Fayard, 2007

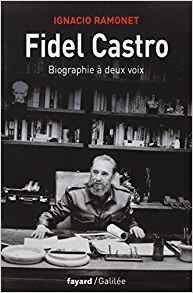
Deje un comentario